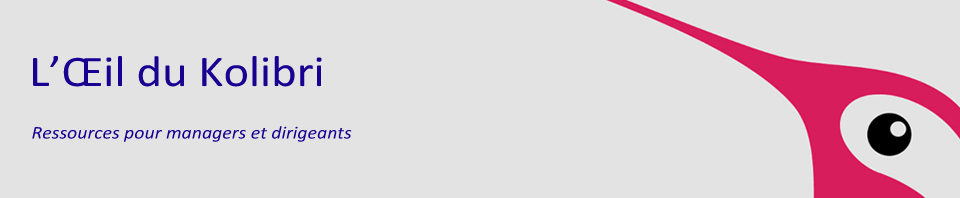Les injonctions paradoxales sont fréquentes en entreprise et mettent sous tension ceux qui les reçoivent. Comment réussir à faire une chose et son contraire ? Comme par exemple innover sans sortir des règles établies ? La fréquence de ces messages contradictoires interroge. S’agit-il de malice managériale ? Sans doute plutôt d’exigences contraires qui obligent chaque niveau hiérarchique à concilier l’inconciliable. Comment alors détecter l’injonction paradoxale et en sortir ? Et comment éviter de donner des injonctions paradoxales ?
Les injonctions paradoxales sont fréquentes en entreprise et mettent sous tension ceux qui les reçoivent. Comment réussir à faire une chose et son contraire ? Comme par exemple innover sans sortir des règles établies ? La fréquence de ces messages contradictoires interroge. S’agit-il de malice managériale ? Sans doute plutôt d’exigences contraires qui obligent chaque niveau hiérarchique à concilier l’inconciliable. Comment alors détecter l’injonction paradoxale et en sortir ? Et comment éviter de donner des injonctions paradoxales ?
“Ne lisez pas cette phrase.”
Ça y est, vous voilà pris dans une injonction paradoxale ! Un message qui contient deux injonctions incompatibles. “Ne pensez pas à la tour Eiffel”. Encore raté !
Ce serait un jeu amusant si cela ne donnait pas, en entreprise, des situations de stress et de souffrance. C’est le cas quand nous cherchons à obéir à deux exigences contradictoires. Par exemple, “Innovez, mais respectez les règles”. Ou bien, “Ne fais pas toujours ce que je te dis”. Ou encore “Sois plus autonome mais fais-moi un reporting quotidien”.
Le problème ? La demande contient deux messages qui se contredisent. Par conséquent, en obéissant à l’un, on désobéit à l’autre, si bien qu’il est impossible de faire bien. Nous voilà bien tiraillé.e, dans l’impossibilité de choisir entre les deux injonctions. Coincés dans un dilemme, voire dans un paradoxe.
Injonction paradoxale ou contradiction ?
Quelle différence entre injonctions contradictoires et paradoxe ? Dans la contradiction, nous pouvons choisir et résoudre la tension. Nous échappons au dilemme. Dans l’injonction paradoxale, nous sommes coincés, à moins de métacommuniquer – voir plus bas.
Un exemple de simple contradiction :
Je trouve logique la position proposée par mon N+2. Et j’ai entendu via une collègue RH que mon N+1 était sur la sellette en raison de son mode de management trop directif pour l’entreprise.
Alors, tout bien pesé, entre l’injonction de mon N+1 “durcis le ton” et celle de mon N+2 “reste souple”, je peux choisir de suivre la seconde : le prix à payer à désobéir à la première, me paraît raisonnable.
En version paradoxale :
En revanche, si dans la même situation il est pour moi aussi crucial d’obéir à mon N+1 qu’à mon N+2, je ne peux résoudre la contradiction et suis pris.e dans une contrainte forte, voire un dilemme. Si l’enjeu est très grand, et qu’en plus je n’ai aucun moyen de nommer ce dilemme auprès de mes hiérarchiques, je peux me trouver dans une double contrainte.
Le paradoxe dans l’interaction : paradoxe pragmatique et injonction paradoxale
Les deux exigences contradictoires peuvent se trouver dans la même phrase ou bien dans deux demandes séparées, à des niveaux distincts. Ces niveaux ont été explicités grâce au travail de l’anthropologue Gregory Bateson sur le « paradoxe de l’abstraction dans la communication », le travail sur la “communication paradoxale de Paul Watzlawick et l’équipe des chercheurs du groupe de Palo Alto.
Dans Une logique de la communication (1), Paul Watzlawick, Janet Beavin et Don D. Jackson classent les paradoxes en 3 types :
- les paradoxes logico-mathématiques,
- les définitions paradoxales (paradoxes dans la sémantique) comme le paradoxe du Crétois (qui dit “Tous les Crétois sont menteurs.”)
- les paradoxes pragmatiques, dont l’injonction paradoxale fait partie (ainsi que les “prévisions paradoxales”)
Nous nous intéressons ici au 3e type, le paradoxe pragmatique et l’injonction paradoxale. Les auteurs donnent l’exemple du paradoxe du barbier.
Le paradoxe du barbier
Absurde ? Certainement. Et intenable si le soldat n’a pas la possibilité de nommer le paradoxe auprès de son capitaine. Les auteurs commentent :
“Les paradoxes pragmatiques, surtout les injonctions paradoxales, sont en réalité beaucoup plus fréquents qu’on ne pourrait le croire. Dès qu’on étudie le paradoxe dans des contextes d’interaction, ce phénomène cesse de n’être qu’une fascination de l’esprit pour le logicien et le philosophe des sciences, et devient un sujet d’une importance pratique considérable pour la santé mentale des partenaires, qu’il s’agisse d’individus, de familles, de sociétés ou de nations. “
(ibid, page 196)
L’injonction paradoxale en 2 temps
Les deux injonctions contradictoires peuvent être dans la même phrase (comme dans le paradoxe du barbier), mais plus souvent elles sont présentes à 2 niveaux différents, comme le verbal et le non verbal, ou bien en 2 temps comme avec une demande explicite et un feedback implicite.
Un exemple :
Demander une chose et son contraire
Un manager va voir sa RH et lui demande “Aide-moi à résoudre ma problématique de management”. Puis, pendant l’échange, il rejette l’aide proposée par sa RH : chaque fois qu’elle pose une question, il répond à côté ; chaque fois qu’elle propose une autre vision des choses ou apporte une solution, il objecte. Le comportement de ce manager envoie un message opposé à sa demande exprimée en mots.
Ainsi la RH, en tentant de répondre à la demande d’aide, rencontre toujours plus de refus de la part du manager qui la lui demandait. Peut-être que dans sa manière de faire, la RH renforce aussi cette “résistance”, et obtiens “toujours plus de la même chose”.
Sortir de l’injonction paradoxale
Pour sortir de cette contradiction, la RH la nomme : “Tu me demandes de t’aider, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. En effet j’ai l’impression que mes questions te dérangent, car tu changes chaque fois de sujet. Et je ressens que mes propositions de solutions ne t’intéressent pas. Je me trompe ? Qu’attends-tu de moi ?”
En nommant la contradiction par une métacommunication – une communication au sujet de leur communication à tous deux – la RH a changé de niveau logique dans la conversation. Le manager accepte ce changement, et répond “En fait, je ne suis pas à l’aise parce que je me sens pris en défaut, et si c’est toi qui résous le problème c’est comme si j’étais incompétent, comme manager.”
Ainsi les règles du jeu sont-elles explicitées : le manager reconnaît qu’il est réticent à accepter l’aide qu’il a demandée. La RH peut alors lui demander “Comment on peut avancer ensemble d’une manière qui te convienne ? Qu’attends-tu de moi ?” Et ouvrir une porte de sortie hors du paradoxe où elle commençait à s’embourber, paradoxe qui pourrait s’appeler “Aide-moi sans m’aider”.
Note : les jeunes enfants sont parfois pris dans cette contradiction. Frustrés de ne pas réussir à monter un jouet, ils demandent l’aide du parent tout en la rejetant avec colère parce qu’ils voudraient réussir tout seuls.
Mais au fait, pourquoi y a-t-il autant d’injonctions contradictoires, voire paradoxales, dans nos entreprises ?
Concilier des contraintes incompatibles mène au paradoxe
En fait, l’injonction à effet paradoxal n’en porte généralement pas l’intention. Ce serait fort manipulateur, est-ce si courant ?
En réalité, c’est le besoin de concilier de nombreuses contraintes qui oblige le management à ce “et en même temps” générateur de paradoxes. Alors, ce qui apparaît comme une incohérence managériale révèle une pression pour concilier des intérêts divergents (ou exigences divergentes) : risque et sécurité, performance et bien-être, etc.
Ainsi, le manager est lui-même pris dans des injonctions paradoxales : “obtiens le maximum de ton équipe, mais ne les pousse pas au burn-out” ; “assure une productivité maximale, avec une qualité optimale”.
Le pire, c’est que l’on ne relève plus le paradoxe. “Faire plus avec moins” est devenu presque naturel. Moins de moyens, d’effectifs, mais une croissance nécessaire. A ne plus les relever, nous laissons les injonctions paradoxales s’installer dans le quotidien.
Quelques injonctions paradoxales courantes :
Dans la catégorie “Au four et au moulin” :
“Prends le temps de gérer ton équipe mais assure ta part de production”
“Investis-toi sérieusement dans les groupes de travail transverses mais suis tes dossiers et ton équipe de près”
“Va voir tes clients tous les jours” (Et chaque fois que ce commercial n’est pas à son bureau, le N+1 le cherche et s’agace)
Dans la catégorie “Tends le bâton… pour te faire battre” :
“Dis la vérité sur l’avancement de tes projets” dit le directeur de production au chef de projet (mais chaque fois que l’avancement annoncé n’est pas satisfaisant, le directeur tombe à bras raccourcis sur ce chef de projet)
“Sois proactive, fais-moi des propositions pour le plan de communication” (et chaque fois que la responsable de communication en fait, elle essuie une pluie de reproches parce que rien ne convient au directeur… qui refait tout le travail)
Dans la catégorie “Multiplie les pains” :
“- Fais +30% cette année sur tes objectifs commerciaux.
– Mais… j’ai une commerciale en congé maternité et un qui vient de démissionner… On recrute ?
– Non pas besoin de recruter. L’an dernier vous avez réussi à l’aise. Donc ça passe”
Souvent, nous n’avons pas conscience de donner des injonctions contradictoires. Nous avons simplement besoin d’obtenir le beurre et l’argent du beurre, de la part de notre interlocuteur. Pris dans des contraintes fortes (ou en tout cas, que nous percevons comme incontournables), nous cherchons à résoudre la tension en demandant la lune à notre interlocuteur. Ce serait bien arrangeant si nous pouvions l’obtenir et résoudre notre propre injonction paradoxale.
Sortir du piège : jouer sur les seuils ou nommer la contradiction
Alors que faire quand on se sent ainsi tiraillé, frustré, voire en échec ? Le piège, c’est de continuer ses tentatives pour réussir à tout concilier. La direction vers la sortie ? Repérer l’incompatible, puis en négocier les termes, ou l’exprimer.
Jouer sur les seuils
En premier lieu, vérifier au passage si nous pouvons ramener cette injonction double à une simple contradiction. Le critère : on la résout en choisissant l’une ou l’autre des deux possibilités. S’il n’est pas possible de choisir, c’est un paradoxe qu’il faut alors nommer.
Autre option : préciser les termes de la contradiction et jouer sur les seuils pour concilier l’ensemble.
Reprenons cet exemple :
“Investis-toi sérieusement dans les groupes de travail transverses mais suis tes dossiers et ton équipe de près”
Bien sûr, si je m’astreins à accomplir parfaitement ce qui est demandé des deux côtés, je suis en difficulté.
C’est là que le paradoxe sorite, ou paradoxe du tas, peut m’aider.
Le paradoxe sorite ou “paradoxe du tas”
Ce paradoxe fut formulé par le grec Eubulide au IVe siècle av. J.-C. En voici l’énoncé :
1. un grain isolé ne constitue pas un tas
2. l’ajout d’un grain ne fait pas d’un non-tas, un tas.
Conclusion : on ne peut constituer un tas par l’accumulation de grains.
Réciproquement, ce paradoxe dit :
Si j’enlève un grain à un tas, cela reste un tas.
Si j’enlève tous les grains un à un, à chaque étape cela reste un tas.
Et quand il ne reste qu’un grain, j’ai toujours un tas. Même sans grain !
 Ce paradoxe nous montre l’importance d’une définition quantitative : tant que je n’ai pas précisé à partir de combien de grains j’ai un tas, je ne peux en constituer un. A partir de quand est-ce un tas ?
Ce paradoxe nous montre l’importance d’une définition quantitative : tant que je n’ai pas précisé à partir de combien de grains j’ai un tas, je ne peux en constituer un. A partir de quand est-ce un tas ?
Ou bien : à partir de quand, en tant que chef d’équipe, je mérite le titre de “chef d’équipe senior” ?
Ou qu’est-ce qui sera suffisant pour que je sois un “vrai manager”, pour reprendre l’interrogation d’un manager que j’accompagnais récemment.
Revenons à notre exemple. Tant que les attentes de mon N+1 restent floues, je ne peux résoudre la contradiction :
– “Investis-toi sérieusement” : à partir de quel temps passé ou niveau d’implication mesurable, mon N+1 considère-t-il que je m’investis sérieusement ?
– “Suis tes dossiers et ton équipe de près” : concrètement, quel niveau de suivi est attendu ? Quels critères feront dire à mon N+1 que le suivi est suffisant ?
A ce stade, 2 approches sont possibles :
clarifier le flou, questionner les termes avec le N+1 pour connaître ses attentes précises, en vue de chercher à les satisfaire (avec l’espoir qu’elles puissent finalement l’être)
ou bien, profiter du flou pour fixer soi-même le seuil et les critères suffisants !
Après cette clarification bilatérale ou unilatérale, les symptômes paradoxaux peuvent néanmoins persister. Une autre voie consiste alors à en nommer les termes et à acter qu’il n’est pas possible de réussir.
Méta-communiquer
Métacommuniquer, c’est-à-dire communiquer sur la communication. C’est changer de niveau logique, en prenant de la hauteur pour expliciter ce qui se passe dans l’interaction. (Voir plus haut, l’exemple de la RH)
« Lorsque nous ne nous servons plus de la communication pour communiquer, mais pour communiquer sur la communication elle-même (…), nous avons recours à des conceptualisations qui ne sont pas une partie de la communication, mais un discours sur la communication. Par analogie avec la métamathématique, nous parlerons de métacommunication.”
Une logique de la communication, 1-5, page 35
Selon Gregory Bateson c’est une clé des relations humaines !
“La faculté de communiquer sur la communication, de commenter ses propres actions significatives, est essentielle pour des relations sociales réussies. (…) Pour pouvoir distinguer précisément ce que les autres veulent vraiment exprimer, nous devons avoir la possibilité de commenter directement ou indirectement cette expression.” Gregory Bateson et alii, 1956 (2)
Un exemple de métacommunication :
“Tu me demandes d’assurer le suivi de l’équipe, ce qui me prend, avec mes dossiers, 100% de mon temps. En parallèle tu me demandes de m’investir dans ces groupes de travail. Mais si je le fais, c’est forcément du temps pris sur mes dossiers et mon management. Qu’est-ce qui est prioritaire ?”
Quand la réponse est “tout est prioritaire”, il reste à objectiver le caractère impossible de la mission…
Autre exemple :
“Tu me demandes d’avoir plus de leadership sur le développement de la nouvelle ligne de produits, et en même temps chaque fois que je prends des initiatives, tu n’es pas d’accord. Que veux-tu vraiment ? ”
Ou dans un contexte d’équipe commerciale : “Tu me demandes de développer mon portefeuille client, mais chaque fois que je prends contact avec un nouveau client tu écris à un de tes contacts chez ce client sans me mettre en copie. Comment puis-je prendre ma place ?”
Conclusion
La contradiction nommée ouvre la porte à une clarification des règles du jeu et à une négociation des résultats attendus. Si cet échange n’aboutit pas, nous aurons au moins exprimé l’impossibilité de répondre à la demande paradoxale, et nous ne serons donc pas engagé !
A nous de changer notre norme quand celle que nous nous imposons, comme “toujours satisfaire les attentes de ma hiérarchie”, n’est plus opérante.
Qu’est-ce qui nous empêche vraiment de désobéir à une partie de l’injonction ? Après tout ce n’est peut-être qu’une question de prix à payer. Si j’accepte de payer le prix de mon choix, ou si j’ose métacommuniquer, je peux sortir du dilemme.
Et vous, êtes-vous pris dans des injonctions paradoxales ? Vous demande-t-on de faire une chose et son contraire ? Partagez en commentaire !
Pour prolonger :
Les injonctions en entreprise donnent parfois lieu à des surprises…
Les doubles contraintes sources de souffrance en entreprises, article de Frédéric Demarquet sur le site du SI Institut
Comment certains d’entre nous sont plus susceptibles que d’autres d’être piégés dans les injonctions, par leur capacité d’adaptation…
(1) Une logique de la communication, Paul Watzlawick, J. Helmick Beavin et Don D. Jackson, 1967
(2) « The ability to communicate about communication, to comment the meaningful actions of oneself, is essential for successful social inter course. (…) To discriminate accurately what people are real ly expressing we must be able to comment directly or indirectly on that expression »
Bateson, G. /Jackson, D.D. /Haley, J./Weakland, J. : Toward a Theory of Schizophrenia. In: Behavioral Science 1 (1956) 258.